Leur calvaire (suite) : « Cerné, César tente de s’enfuir. »
Un premier coup de feu claqua derrière moi. Je sortis mon révolver et me retournai. Decelles était déjà tenu en respect par deux boches et les autres s’élançaient à ma poursuite.
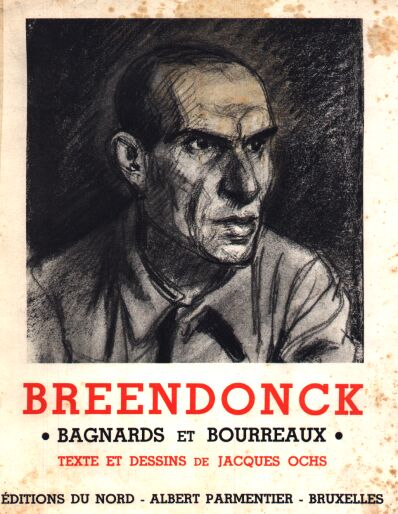
Tout en courant, je tirai plusieurs coups de révolver dans leur direction. Mais les salauds, mieux placés et mieux armés obtinrent un meilleur résultat. Une balle me blessa légèrement à la tête… Puis au moment où je me retournai, je reçus deux balles dans la poitrine, l’une de celles-ci n’est pas encore extraite à l’heure actuelle. Un quatrième projectile me fracassa le coude et je lâchai mon pistolet. Filialement, une cinquième balle m’atteignit à la cuisse, traversa les chairs, ressortit près de l’aine et, avant de se perdre me causa encore une blessure plus épouvantable que les autres.
Le croiriez-vous ? J’étais demeuré debout ! Des témoins peuvent vous l’affirmer. Je me trouvais juste en face de l’entrée des Ateliers Germain et le personnel de cet établissement vit la fin du drame.
Les Allemands me rejoignirent. Ils m’assénèrent sur le visage deux violents coups de crosse de mitraillette, me fendant les arcades sourcilières et brisant mes lunettes dont les fragments de verre me causèrent aussi quelques blessures. Voyez ce cicatrices… Inutile de vous dire que, cette fois, je m’écroulai et perdis connaissance. Je n’ai moi-même connu la suite que par le récit des ouvriers qui assistèrent, tremblants d’impuissance, à une scène de cruauté inouïe. Les Allemands me piétinèrent puis me recouvrirent d’un vieux sac et me laissèrent pour mort. Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite. En quelles circonstances, les boches constatèrent-ils que j’étais encore en vie ? Toujours est-il qu’une voiture d’ambulance me transporta à l’Hôpital Civil de Charleroi où je reçus les soins du docteur Sœur. Soins sommaires, on peut le dire car je ne restai là qu’une heure seulement et on m’embarqua pour l’hôpital Brugman de Bruxelles ; J’y fus installé dans une cave… peut-être les Allemands redoutaient-ils mon enlèvement ?
Cinq jours plus tard, on me transféra à l’infirmerie de la prison de Saint-Gilles. J’étais hors de danger : je devais la vie au fait que mon sang s’était coagulé rapidement, empêchant ainsi l’hémorragie fatale. A peine rétabli, je fus mis en cellule et le 6 mars 1943, je partis pour Breendonck où je retrouvai tous mes camarades de Charleroi et du Centre. Ce que j’ai vu à Breendonck ? Mais vous le savez, sans doute. Tant d’autres ont dû vous raconter déjà ce qui s’est passé là-bas
La tenue rayée des forçats … la faim … le travail en sabots … et toutes les misères.
Les atrocités ? Mais ça faisait partie de l’ordinaire. Comme les autres, j’ai vu Weiss, la brute, battre un prisonnier russe. Le malheureux s’est écroulé ? Alors, le monstre lui maintint la tête dans le sable en lui écrasant la gorge sous sa lourde botte ferrée… Et quand le pauvre Russe voulut regagner sa chambre, il tomba mort enfin délivré de cette vie horrible. Vie horrible à laquelle, nous tenions tous, cependant. Oui, malgré Weiss, malgré les boches, malgré les souffrances, nous voulions vivre. Vous m’entendez : « Nous le voulions ». Et c’est parce que nous le voulions en commun, en nous aidant que beaucoup d’entre nous en sont revenus. Ah ! si tous les hommes voulaient, iI n’y aurait jamais de Breendonck Mais les hommes ne comprennent pas comme nous avons compris là-bas. Il faut souffrir pour comprendre. Je sais bien que ce genre de discours n’est guère intéressant. Vous préférez que je continue à vous parler de monstruosités ?
C’est étrange comme on aime à se repaître de ces histoires. Mieux voudrait en étudier la cause et le remède. Enfin, soit … Je vais donc vous raconter que Weiss, boxeur de profession a battu, certain jour, à coups de poings un Juif qui n’avait plus la force de travailler. Un autre bandit nommé Oblat acheva le malheureux d’un coup de pelle qui lui fit sortir toutes les dents de la bouche. C’était épouvantable, Monsieur. Et nous n’osions rien dire … au moindre geste, nous aurions subi le même sort.
J’ai vu pendre des hommes par les poignets tirés derrière le dos. J’ai vu ces hommes, les bras désarticulés, retomber sur le sol en gémissant. J’en ai vu jeter dans l’eau glacée des fossés. On leur écrasait les doigts quand ils s’accrochaient aux bords… Non, il ne m’est rien arrivé de pareil … Je n’en serais pas revenu … J’étais si faible à cause de mes blessures
Et les cris, les supplications ne faisaient qu’exciter la rage des criminels. Celui qui faiblissait était voué à la mort.
Un jour, alors que, tête baissée, je poussais une benne, quatre ou cinq coups de cravache s ’abattirent sur mes épaules. Mon gardien avait sans doute quelque chose à me dire car les coups étaient la seule façon de parler des geôliers nazis. Et quand ils ouvraient la g…. c’était pour rugir. J’ai supporté les coups en serrant les dents et je n’ai jamais su ce que voulait mon bourreau.
Un autre jour, alors que je subissais les mêmes sanctions injustifiées, je levai la main pour parer les coups. La brute qui me frappait en profita pour m’accuser de l’avoir menacée. Imaginez-vous ce qu’il me fallut de force, de volonté pour ne pas sauter à la gorge du bandit, pour ne pas lui crier toute ma haine et pour ne pas pleurer. Je voulais vivre, Monsieur, et je n’ai rien dit.
Le 15 mars 1943, j’ai bien cru que tout était fini. Hurlant plus que d’habitude, les S.S. pénétrèrent dans notre chambre. L’un d’eux avait en main une liste : une liste de numéros car nous n’étions plus désignés que par des chiffres.
Dix prisonniers devaient être fusillés ce matin-là et trois hommes de notre chambre étaient du nombre. L’appel fatidique commença : « Numéro 1852 »
Je frémis de tout mon être. Je portais le numéro 1854 et il fallait trois hommes pour le poteau. Je pensai à ma femme arrêtée avec moi pour délit de presse clandestine et dont j’étais sans nouvelles depuis si longtemps. Mon cœur se serra. Devais-je abandonner tout espoir de la revoir ?
« 1855 ! »
Le malheureux 1852, si j’ai bonne souvenance ce devait être notre camarade Falise était déjà sorti. J’entendais le bruit lugubre de ses sabots sur le pavé et déjà le 1853 était déjà poussé dehors à coups de cravaches. Mon cœur s’arrêta-t-il ? Ou bien… Je ne sais plus, je n’ai jamais su… Je ne tremblais pas, je ne pensais plus à rien … J’entendis un numéro et je vis qu’on frappait un malheureux qui se cognait au mur en sortant. On avait appelé le 1855, un aveugle.
Une foule de pensées tourbillonna un instant dans mon cerveau. J’étais sauvé momentanément. Mais pourquoi avait-on sauvé mon numéro ? Les boches ne me réservaient-ils pas une fin plus raffinée que la fusillade ?
Là-bas, dehors, le bruit des sabots s’éloignait. Les camarades s’en allaient vers la mort. Mais les assassins n’étaient pas au bout de la liste. Dans la chambre 12, ils ne prirent qu’un homme. Dans la chambre 13, ils appelèrent le brave Martial Van Schelle.
Une heure plus tard, nous entendîmes les salves meurtrières avant de passer nous-mêmes au poteau ou succomber sous les coups de Weis et de ses acolytes.

