À l’occasion des élections de mai 2019, nous avons vu fleurir différentes activités et débats partout en Belgique. Cette époque de joute électorale fut propice à la multiplication des lieux communs habituels au sujet de la gauche. C’est l’époque qui veut ça. Le cliché le plus éculé, qui est remonté à la surface durant cette campagne, est sans doute celui affirmant que le socialisme s’opposerait intrinsèquement aux libertés individuelles. Contrairement, bien sûr, au capitalisme.
Nous tenterons au travers de cette analyse de prendre un peu de hauteur vis-à-vis de ces critiques superficielles et de présenter une synthèse du rapport que le socialisme entretient avec la liberté. Cette réflexion sera ancrée dans l’expérience historique du mouvement ouvrier face à l’exploitation capitaliste.
Genèse du socialisme
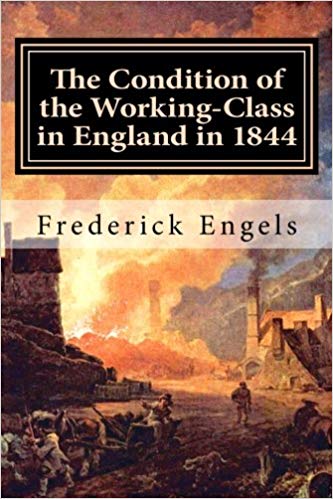
Les origines du socialisme en tant que courant idéologique proviennent à la fois des débats entre intellectuels et plus fondamentalement encore de l’activité des mouvements ouvriers actifs au XIXème siècle. En définitive, le socialisme naît de l’interaction et de l’alliance de ces deux milieux qui se renforceront de manière complémentaire. Nous pouvons prendre l’exemple de Friederich Engels, qui de 1842-1844, écrivit la première ethnographie des milieux ouvriers, The Condition of the Working Class in England[1]. Cette alliance entre les intellectuels et la classe ouvrière se perpétuera au-delà du XIXième, à l’image de Simone Weil qui relatera son expérience dans les usines Renault à partir de décembre 1934. Simone Weil nous laissera, d’ailleurs, un témoignage précieux sur la taylorisation du travail ouvrier dans l’industrie française[2].
Comprendre la genèse du socialisme nécessite d’aller plus loin que le constat d’une alliance entre intellectuels et milieux ouvriers. Cela nécessite de se plonger dans les récits biographiques de ses premiers auteurs. Il s’agit de comprendre ce qui, dans la première moitié du XIXième, a permis à un Karl Marx ou une Emma Goldman de prendre fait et cause pour des populations qui étaient alors considérées comme dangereux [3]. C’est au travers des lectures d’œuvres comme la Sainte Famille[4], l’Idéologie Allemande[5], ou encore en s’attardant à quelques éléments biographiques que l’on remarque que leur situation d’exilés victimes de répressions politiques les a conduits à produire de telles analyses.
Ces répressions elles-mêmes n’étaient pas un fait gratuit et tombé du ciel. Elles visaient à maintenir les différents pouvoirs en place, qu’il s’agisse d’une monarchie parlementaire constitutionnelle ou prussienne. Ce qu’a vécu et observé Marx à l’époque n’était pas une répression spécifique à un système politique, mais le fait d’un système économique qui cherchait à garantir le cadre dans lequel il se développe. Comme nous pouvons encore le constater aujourd’hui, le capitalisme sait très bien s’accommoder de différents types de gouvernements, qu’il s’agisse d’une démocratie libérale ou d’une dictature autoritaire. Le cas du Chili de Pinochet est, de ce point de vue, emblématique.
Le cadre social qu’a expérimenté Marx était celui des premières révolutions industrielles. Il s’agissait très concrètement du travail en usine ou à la mine, sans sécurité sociale ni réglementation du travail. Le quotidien des travailleurs variait, certes, quelque peu selon leur lieu de travail. Ils étaient constamment contrôlés, non par l’état, mais par les industriels eux-mêmes. Chaque travailleur devait posséder, notamment en Belgique, un livret ouvrier, c’est-à-dire un document reprenant l’ensemble des informations d’ordre professionnel et privé le concernant. C’était la méthode utilisée par les propriétaires afin de contrôler les travailleurs récalcitrants. Un ouvrier ayant un passé de syndicaliste ou d’insubordination au travail avait alors peu de chances de se faire réembaucher en cas de perte d’emploi. Il n’y avait, à cette époque, aucun droit à l’oubli ou à la vie privée pour toute une catégorie de la population.

Cette période était également celle du travail des enfants. Rien que dans le Brabant wallon, un recensement de 1846 montre que sur 6680 salariés, il y avait 1589 garçons et filles de moins de 16 ans. 23% de la population salariée de l’époque était donc mineure et comptait des enfants, parfois âgés de moins de 9 ans. On trouvait, de surcroît, 25 garçons de 9 à 12 ans dans les carrières, 8 garçons et 4 filles de moins de 9 ans dans les filatures de coton, 6 garçons et 7 filles de moins de 9 ans dans les fabriques de tissu et de coton ainsi que 11 garçons et 4 filles entre 9 et 12 ans dans les papeteries. Le progrès économique tant vanté par les libéraux ne s’accompagnait donc pas forcément du progrès social tant promis.
En 1896,
le Brabant wallon comptait encore 376 garçons et 102 filles de moins de 14 ans
au travail, ainsi que 694 garçons et 263 filles de moins de 16 ans, soit 1435
enfants encore au travail. Les journées de travail ne s’étaient toujours pas
écourtées. Elles duraient de 10 à 12 heures suivant les saisons dans une
majorité d’entreprise. On retrouve une journée de travail de 11 heures dans une
fabrique de fer. Plusieurs ateliers de construction et tuileries imposaient
des journées de 12 heures. La journée de travail était de 15 heures dans les
briqueteries et certains moulins à farine en été. [6]
La liberté des patrons se traduisait alors par des enfances sacrifiées, des
membres mutilés et des vies perdues. Derrière la liberté formelle, qui flotte
dans le ciel des idées et des théories politiques de la bourgeoisie, on
trouvait surtout la dure réalité de l’exploitation typique des débuts de la
société industrielle.
On pouvait encore recueillir ce type de témoignage dans la France de 1936 :
« J’ai oublié de noter mon impression le 1er jour, à 8 h, en arrivant au bureau d’embauche. (…) Je trouve 5 ou 6 ouvrières qui m’étonnent par leur air morne. J’interroge, on ne dit pas grand-chose ; je comprends enfin que cette boîte est un bagne (rythme forcené, doigts coupés à profusion, débauchage sans scrupules) et que la plupart d’entre elles y ont travaillé – soit qu’elles aient été jetées sur le pavé à l’automne, soit qu’elles aient voulu s’évader – et reviennent la rage au cœur, rongeant leur frein. » [7]
Julien Scharpé
A suivre
[1] Engels F., The Condition of the Working Class in England, https://www.marxists.org/francais/engels/works/1845/03/fe_18450315.htm
[2] Weil S., La Condition ouvrière, Folio Essais, Gallimard, Paris, 2002.
[3] Mols Roger. Chevalier (Louis). Classes laborieuses et Classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle. In : Revue belge de philologie et d’histoire, tome 39, fasc. 1, 1961. Antiquité – Houdeid. pp. 145-150.
[4] Œuvre consultable sur le lien suivant : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900.htm
[5] Œuvre consultable sur le lien suivant :http://classiques.uqac.ca/classiques/Engels_Marx/ideologie_allemande/ideologie_allemande.html
[6] Aperçus de l’histoire sociale et économique du Brabant-Wallon de 1846 à 1971, Archives du Carhop (Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire), page 8.
[7] Weil S., La condition ouvrière, p.74